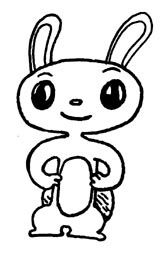La porte des Enfers
Laurent Gaudé

Dans la mythologie gréco-romaine, il existe cet endroit souterrain appelé les Enfers, là où vont les morts après leur passage sur Terre. Hadès y règne, jaloux de ce monde d’ombres. Un jour, il décida de prendre femme et enleva Perséphone, fille de Déméter, déesse de la fertilité. Inconsolable, Déméter cessa de nourrir la terre et les champs pleurant pour que sa fille lui soit rendue. Pris de pitié, Zeus accorda donc à Perséphone le droit de revenir à l’air libre près de sa mère six mois dans l’année ; ainsi, le printemps et l’été, Déméter se réjouit tandis que l’automne et l’hiver elle pleure sa fille cloîtrée auprès de son époux.
C’est sur ce thème des Enfers que s’appuie le dernier roman de Laurent Gaudé : La porte des Enfers. L’histoire se passe à Naples. En 1980, Matteo voit toute sa vie voler en éclats ; son fils Pippo, six ans, est pris dans une fusillade entre deux gangs et meurt dans ses bras. Sa femme Giuliana, inconsolable, exige de son mari qu’il lui ramène son fils ou, tout du moins, qu’il venge sa mort. Matteo se révèle incapable de tuer le meurtrier de son enfant et, demeuré seul, il erre dans les ruelles obscures de la ville la nuit jusqu’à rencontrer un jour un petit groupe d’excentriques. Il y a Grace, un travesti, Garibaldo, un patron de café débonnaire, Don Mazerotti, vieux prêtre farfelu et, enfin, le professeur Provolone. C’est ce dernier qui va révéler à Matteo le moyen de descendre chez les morts par une porte connue de lui seul. Ainsi, si Matteo ne peut venger son fils tout du moins pourra-t-il le ramener des Enfers et tenir ainsi la promesse faite à sa femme…
Autant vous le dire, j’ai été un peu déçue. Toutes les personnes qui avaient lu ce livre m’en avait fait une critique élogieuse et je m’attendais donc à une véritable révélation. Au lieu de ça j’ai découvert un honnête roman, un peu pompeux sur les bords (je n’ai pas été plus surprise que ça de découvrir que Gaudé était aussi dramaturge) avec des personnages qui frisent parfois la caricature. Seuls les personnages principaux, le père, la mère et le fils, sont vraiment fouillés et de ce fait ont une véritable épaisseur. Ceci dit, je dois avouer que j’ai pris du plaisir à lire cette histoire sombre, très sombre qui aborde le deuil d’une manière originale et émouvante. Gaudé réussit à merveille à retranscrire la douleur de parents qui perdent leur enfant, révolte pour Giuliana, résignation pour Matteo. Les morts ne partent pas seuls nous dit Gaudé, ils emmènent avec eux une part des vivants qui les ont aimés. Image très forte que l’on retrouvera au moment de la descente aux Enfers quand Matteo verra les morts s’engouffrer dans des buissons, laissant ça et là des morceaux de chair appartenant à ceux d’en haut… A ce message un peu amer, l’auteur apporte cependant une touche d’espoir : l’amour de Matteo pour son fils parvient à ramener ce dernier à la vie, même s’il lui faut en contrepartie sacrifier la sienne. Un sacrifice que le moment venu, le fils, quand viendra son tour, sera incapable de faire.
Oui, me dites-vous, mais qu’en est-il des Enfers à proprement parlé ? Comment Gaudé les imagine-t-il ? C’est sans doute là le moment le plus fort du récit et la descente aux Enfers permet au style de l’auteur de prendre toute sa pleine mesure. Le ton un brin mélodramatique s’accorde parfaitement à ce royaume où les ombres comme malgré elles quittent un à un les attraits de la vie ; il y a le fleuve des âmes où tous les défauts des morts sont grossis et déformés, les dégoûtant ainsi de ce qu’ils étaient de leur vivant, il y a les Buissons Sanglants qui les débarrassent des restes de ceux qui les ont aimés… Dans ce pays gémissant et grisâtre, les morts ne demeurent que grâce aux souvenirs et aux regrets de leurs proches. Oubliés, ils disparaissent rapidement…
C’est une histoire poétique, émouvante, notamment grâce à la figure de ce père aimant qui, résigné à la perte de son fils est de ce fait le plus apte à le récupérer. Laurent Gaudé ne cherche pas à rendre la mort plus légère mais ne la considère pas comme une fin en soi, partant du principe que la mort c’est l’oubli et que tout ce qui n’existe pas ici est vivant « là-bas » La mort de ceux que nous aimons nous fait mourir un petit peu nous-même, mais c’est paradoxalement ce qui nous façonne…